Tikographie, Entretien avec Michel Jouinot, Président de l’antenne de Beaumont des Jardiniers Pays d’Auvergne
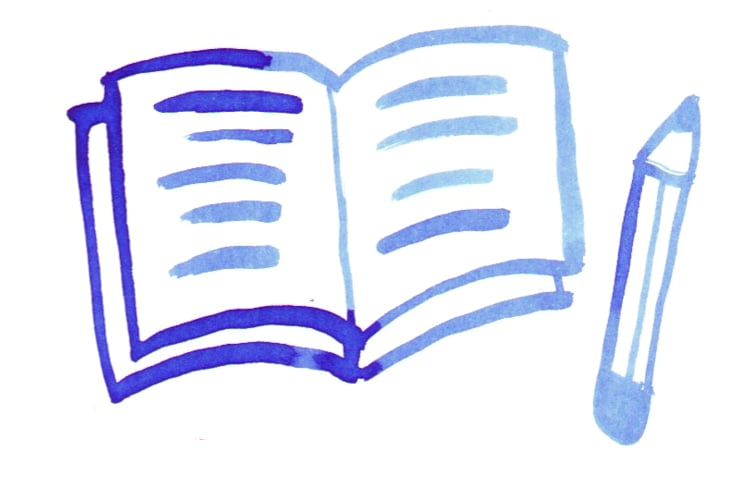
A l’origine de l’antenne beaumontoise des Jardiniers Pays d’Auvergne et fort d’une longue expérience dans le milieu agricole national, Michel Jouinot livre sa vision critique des dégâts qui y sont causés par le productivisme.
Ta passion pour le monde végétal t’a poussé à participer à la création du club des Jardiniers du Pays d’Auvergne [JPA] …
J’ai en effet adhéré en 2019 à l’association Les Jardiniers des Pays d’Auvergne. Elle avait été créée en 2013 quand le groupement des Jardiniers de France a périclité au niveau national et a poussé des jardiniers auvergnats à s’organiser. Les Jardiniers du Pays d’Auvergne regroupent aujourd’hui environ 1600 membres au sein de vingt-six clubs, dont six sont organisés en associations.
De mon côté, j’ai fondé celle de Beaumont – où j’habite – en 2021. C’était important pour moi car l’organisation des JPA sur ma commune ne me satisfaisait pas. En effet, le club de Beaumont servait uniquement de centrale d’achat, et il manquait pour moi une dimension pédagogique, et une animation conviviale.
Comment as-tu développé ce volet sur Beaumont ?
Avec les membres des JPA Beaumont, nous sommes partis à la recherche d’un terrain pour en faire un jardin pédagogique. Cela devait être un site ouvert aux membres, mais aussi aux habitants et aux scolaires. Il fallait que cela soit un véritable jardin partagé et convivial.
« Il fallait que cela soit un véritable jardin partagé et convivial. »
Nous avons fini par trouver un terrain de 1600 mètres carrés, en bordure de l’Artière, avec un loyer intéressant. Il n’avait pas été cultivé depuis plusieurs années. Après l’avoir remis en culture, vu qu’il n’était pas clos, des chevreuils venaient allègrement se servir. De plus, étant très proche du parc De Bussy [parc public à Beaumont], ballons et chiens venaient l’endommager.
C’est pourquoi, en 2022, le club JPA Beaumont a déposé un dossier auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Budget Eco-Citoyen. Nous avons été lauréats, et un montant de 8600 € nous a été alloué pour installer une clôture et acheter du matériel de jardinage.
 Au jardin pédagogique des JPA de Beaumont, visite du site avec Michel (à droite) en présence de Jean-Paul Cuzin, maire de Beaumont, et Jean-Philippe Perret, vice-président à la transition écologique au Conseil Départemental / Crédit photo : JPA Beaumont (DR)
Au jardin pédagogique des JPA de Beaumont, visite du site avec Michel (à droite) en présence de Jean-Paul Cuzin, maire de Beaumont, et Jean-Philippe Perret, vice-président à la transition écologique au Conseil Départemental / Crédit photo : JPA Beaumont (DR)
Tu disposes aussi d’un jardin personnel de belle taille. Comment fais-tu le lien entre ces deux espaces ?
Je teste beaucoup de pratiques et de dispositifs d’abord chez moi, puis je les transfère dans le jardin partagé quand elles sont efficaces. Par exemple, j’avais un gros problème avec les frelons asiatiques. Comme il est vital de se passer des pesticides – ce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore – j’ai testé différents systèmes de pièges et d’appâts.
Et il s’avère que, sur le frelon asiatique, on peut tous agir ! Si chacun mettait en place un petit piège adéquat, on ne l’éliminerait pas mais on pourrait le faire régresser. Personnellement, j’ai trouvé un système de pièges et d’appâts qui m’a permis de piéger 250 femelles frelons – dont 40% d’asiatiques – avec six pièges. Bien sûr, point indispensable pour moi, sans impacter les abeilles.
« Je teste beaucoup de pratiques et de dispositifs d’abord chez moi »
Mais ce test a pris trois ans ! Il faut tout prendre en compte : la taille du piège, le positionnement dans le jardin et notamment la hauteur par rapport au sol, la fréquence d’entretien, et surtout, le produit utilité pour appâter : ce dernier ne doit pas attirer les abeilles. (…) Maintenant que j’ai atteint un taux de “réussite” satisfaisant, je vais acheter d’autres pièges similaires pour les installer dans le jardin pédagogique.
Le végétal est-il une bonne solution aux problématiques d’habitat et de vie en ville ?
J’en suis convaincu. Je cherche depuis longtemps à utiliser au mieux le végétal local – c’est important – pour faciliter notre adaptation au changement climatique. Chez moi, toutes les gouttières sont ornées d’une glycine chinoise qui produit une ventilation naturelle par un léger mouvement de ses feuilles, même sans vent ! Mais cela prend du temps à faire pousser, à orienter correctement, à entretenir : il m’a fallu plus de quinze ans pour atteindre le résultat auquel nous sommes parvenus.
« Il faut arrêter de planter des résineux »
Idem pour les arbres qui produisent de l’ombre voire de la fraîcheur, comme les noyers. Ce sont des végétaux locaux ! Et ce message est capital pour la sensibilisation des jardiniers tout autant que de l’ensemble de la population. Il faut arrêter de planter des résineux, souvent gourmands en eau et, pour certains, gîte dramatique des chenilles processionnaires.
 La glycine chinoise qui court sous la gouttière, le long de la maison de Michel, apporte une ventilation mécanique naturelle à l’ensemble du bâtiment. Mais il faut des années pour qu’elle pousse complètement / Crédit photo : Damien Caillard, Tikographie
La glycine chinoise qui court sous la gouttière, le long de la maison de Michel, apporte une ventilation mécanique naturelle à l’ensemble du bâtiment. Mais il faut des années pour qu’elle pousse complètement / Crédit photo : Damien Caillard, Tikographie
Comment fais-tu face au problème de l’eau ?
Dans mon jardin, j’ai fait creuser une mare, étanchée à l’aide d’une bâche, qui me permet de stocker près de soixante mètres carrés d’eau de pluie récupérée depuis l’ensemble des toitures de la maison.
J’ai aussi testé un paillage renforcé à base de grands morceaux de carton – non imprimés – recouverts de tonte. C’est de loin la meilleure solution pour conserver l’humidité. De plus, les vers de terre sont extrêmement friands de cette nourriture !
Dans le jardin partagé, à l’aide d’une pompe électrique, nous pouvons pomper soit dans le puits soit dans le ruisseau voisin en crue, et stocker l’eau dans des réserves. Et, l’été, nous n’utilisons que le puits.
« Ne mettre que des plantes vivaces, résistantes à la sécheresse, dans les massifs floraux »
Mon jardin d’ornement est constitué quasi uniquement de fleurs n’ayant pas besoin d’arrosage (sauges, lavandes, …..). C’est ce message que je voudrais faire passer aux collectivités pour l’entretien des espaces verts : ne mettre que des plantes vivaces, résistantes à la sécheresse, dans les massifs floraux. Cela peut demander deux ou trois ans pour qu’elles s’installent et créent de jolis massifs.
Le souci est que beaucoup d’élus des collectivités, tout autant que des techniciens, des jardiniers ou agents d’entretiens, veulent que “ça soit beau tout de suite” … peut-être sous la pression des habitants. Et c’est fort dommage pour le changement climatique où chacun doit être un colibri.
 La mare que Michel a creusée au fond de son jardin abrite de nombreuses espèces animales et permet le foisonnement d’espèces végétales / Crédit photo : Michel Jouinot (DR)
La mare que Michel a creusée au fond de son jardin abrite de nombreuses espèces animales et permet le foisonnement d’espèces végétales / Crédit photo : Michel Jouinot (DR)
Plus largement, tu estimes qu’il y a un enjeu de compétences dans la fonction publique…
Je suis en effet persuadé que la fonction publique doit se cantonner au domaine régalien – police, justice, impôts, armées, hôpitaux publics et universitaires, éducation. De nombreux autres devraient être externalisés ! En outre, la fonction publique est de moins en moins attractive, notamment au niveau des salaires. S’en suit une perte de compétences.
« La fonction publique doit se cantonner au domaine régalien «
A cela s’ajoutent les problèmes d’organisation du travail, comme l’absence de banque horaire comme dans les métiers saisonniers, notamment pour les espaces verts. Pour cette raison, on ne pourrait pas confier une ceinture maraîchère à des agents territoriaux.
Si l’on fait un parallèle, quand une entreprise privée répond à un appel d’offres lors de travaux, elle a deux obligations : une obligation de résultats vis-à-vis de la collectivité aussi bien dans la réalisation que dans les délais, et une obligation économique puisqu’elle doit être rentable, sinon, elle disparaît.
De par ta carrière, tu portes aussi une vision critique sur la logique productiviste du monde agricole. Comment se traduit-elle ?
Après la guerre, dans les années 50/60, il était nécessaire de faire de la productivité agricole pour nourrir la population. Cette autonomie a été atteinte à la fin des années 60. Mais, le dogme de la productivité a été conservé sans tenir compte de la rentabilité. N’oublions pas que l’agriculture est fortement soutenue par des aides communautaires.
Toutes les difficultés que l’on constate chez les agriculteurs – surendettement, utilisation massive d’intrants et de pesticides, gigantisme des machines, course à la surface… – sont dues à cette logique de productivité poussant à faire “toujours plus”. Cela épuise les sols et tue les écosystèmes.
 Le carton, qui dépasse de sous le paillage en tonte sèche, est ici la meilleure manière de conserver l’eau dans le sol et de limiter les besoins des végétaux / Crédit photo : Damien Caillard, Tikographie
Le carton, qui dépasse de sous le paillage en tonte sèche, est ici la meilleure manière de conserver l’eau dans le sol et de limiter les besoins des végétaux / Crédit photo : Damien Caillard, Tikographie
Tu es particulièrement sensible à la disparition des haies…
En effet, et je l’ai d’abord constaté dans mon pays de naissance, en Charente-Maritime où les haies étaient constituées essentiellement d’ormes. Cette mono-espèce a été atteinte par un insecte importé du Canada qui les a détruits en moins de 10 ans. Cela devrait attirer notre attention sur le boisement en mono-variété, quel qu’il soit.
Par ailleurs, la culture intensive, notamment de maïs et d’autres céréales, ainsi que le tournesol, a conduit à constituer des parcelles toujours plus grandes. Ce phénomène, accentué par le remembrement, a contribué aussi à la disparition de plus de 70 % des haies en France.
Dans le même temps, le drainage des zones humides, le tassement des sols agricoles par des engins de plus en plus lourds et le non-labour, ont entraîné un ruissellement des eaux vers les rivières. Conséquence : l’absence d’infiltration vers les nappes phréatiques.
Quelle solution préconises-tu ?
Je pense que l’on doit changer de paradigme pour le modèle agricole. Au niveau économique, il faudrait passer d’une logique de productivité à une logique de rentabilité. Il est, aussi, important que la vente des produits phytosanitaires et engrais chimiques soit séparée du conseil agricole par un texte de loi. A mon sens, c’est l’unique moyen de freiner cette fuite en avant.
« Toutes les difficultés que l’on constate chez les agriculteurs (…) sont dues à cette logique de productivité poussant à faire “toujours plus”. «
En parallèle, on peut associer des “droits” à des actions de restauration de l’écosystème. Par exemple, instaurer un droit de pompage dans des rivières, lors des crues, pour stocker l’eau dans des bassins séparés des cours d’eau, associé à la replantation de haies. Il faut éviter les barrages collinaires qui perturbent la vie biologique des cours d’eau.
Tu évoquais les intrants. Est-ce vraiment possible de s’en passer ?
Ce sera très difficile, simplement parce que c’est un business pour les coopératives et les industriels. En effet, ces derniers achètent les intrants en gros et les revendent au détail aux agriculteurs. La marge qu’ils génèrent de cette façon est capitale pour leur modèle économique.
En parallèle, il n’y a peu d’autres modèles qui émergent vraiment. Certains agriculteurs, notamment dans l’ouest, replantent des haies, labourent leurs terrains et utilisent des engrais verts. Mais c’est encore à la marge. Cependant, il semble que la rentabilité de l’exploitation en soit améliorée.
Quand au bio … Des cultures peuvent-elles être exemptes de pesticides résiduels quand elles prennent place sur un terrain auparavant cultivé en “conventionnel”’ pendant 20 ou 30 ans, sachant que la durée de rémanence de certains intrants peut être centenaire ?
L’autre levier est purement et simplement d’interdire certaines substances comme le glyphosate. Ce dernier permet de ne pas labourer, mais il stérilise la terre et impose l’utilisation des tracteurs de 10 tonnes tractant des remorques et autres engins encore plus lourds qui compactent le sol. Résultat, encore une fois : quand il pleut, l’eau ruisselle sans être stoppée par les haies qui ont été arrachées.
A l’inverse, il faut replanter des haies, refaire du labour. Et inciter à utiliser et produire des “engrais verts”, complètement naturels : phacélie, moutarde… à broyer et enfouir. Après ce couvert végétal, entre deux semis, et le labourage, les adventices poussent beaucoup moins ! Et ça remet de la vie dans la terre. Ces solutions sont connues et éprouvées.
 La dimension convivialité était capitale dans la décision de reprendre l’antenne beaumontoise des JPA, selon Michel. Ici, atelier légumes et cuisine dans le jardin partagé / Crédit photo : JPA Beaumont (DR)
La dimension convivialité était capitale dans la décision de reprendre l’antenne beaumontoise des JPA, selon Michel. Ici, atelier légumes et cuisine dans le jardin partagé / Crédit photo : JPA Beaumont (DR)
Tu revendiques une approche pragmatique dans les pratiques agricoles, au sens large…
Oui, et cela me fait parfois bouillir face à certaines positions d’écologistes dogmatiques. Par exemple, dans le refus d’une serre chauffée l’hiver pour faire lever des semis. Les aubergines, tu les sèmes en février ; il faut chauffer un minimum ! On parle ici d’un mois et demi de chauffage hors-gel, à 5 degrés, juste avant le printemps. Cela représente une bouteille de propane. En fait, j’ai l’impression d’être plus écologiste que certains, parce que je mets en œuvre tous ces principes dans mon jardin.
De même pour l’eau : je suis pour le stockage de l’eau ! Mais pas n’importe lequel. Les retenues collinaires – qui sont des petits barrages sur des rivières – sont à proscrire, car elles impactent la dynamique du cours d’eau et réchauffent l’eau qui sera relarguée. De même pour le pompage en nappe souterraine : on n’y touche plus ! En revanche, une bassine qui prélève de l’eau en période de crue hivernale ne me choque pas. Surtout si c’est associé à une obligation de replantation de haies, comme je l’évoquais.
Que peut-on faire au niveau du couvert forestier ?
Il faut réadapter les forêts au changement climatique, pour éviter autant le risque incendie que la perte de biodiversité. Là aussi, les plantations de douglas d’après-guerre ont généralisé la monoculture d’arbres. Et ce type de plantations se fait encore de nos jours !
« [Les intrants sont] un business pour les coopératives et les industriels. »
En outre, la logique de productivité dont je parlais s’applique malheureusement à la forêt. Avant, les banques et les assurances investissaient dans ce domaine, mais sans attendre de retour à moyen terme – plus de 20 ans. Aujourd’hui, les coupes rases se font souvent tous les 10 à 15 ans, même sur des zones protégées ! En un ou deux jours, tout est ratiboisé. Ce pour replanter de la monoculture et satisfaire le besoin de productivité, avec le risque d’une maladie ou d’un insecte spécifique d’une variété, comme cela a existé sur l’orme il y a 50 ans.
Au final, ce qui me semble important, c’est de considérer ces enjeux écologiques dans leur dynamique globale. Il faut prendre les choses comme un ensemble, et avec du recul. Utiliser le microscope est souvent contre-productif.
Et le Massif Central te semble correspondre à cette nouvelle approche ?
Les agriculteurs, et plus largement les habitants du Massif Central, ont une “tradition de rentabilité”, si je puis dire ! Ils sont connus pour cela. Tout simplement parce que le vétérinaire, c’est cher. Il vaut mieux éviter de le faire venir. Et, donc, on tâche de préserver la santé de ses animaux, de ses plantes, de sa terre…
Nous sommes donc mieux armés ici pour réaliser ce changement de logique. Et, quand on aura démontré largement que l’on gagne plus d’argent en cherchant la rentabilité que la productivité, et en préservant les écosystèmes, tous les autres acteurs de l’agro-alimentaire y viendront.
Contenus complémentaires proposés par Michel :
Pour comprendre – « s’intéresser à toutes les presses qui encouragent les agriculteurs dans la voie de la rentabilité, c’est une vraie démarche environnementale et écologique »